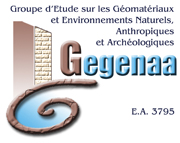Nous portons ou collaborons à différents projets Ministère de la Culture d’archéologie sur les meules ou sur la céramique.
Nous sommes également associés à un dépôt de projet ANR, porté par l’UMR Trajectoire de Nanterre, qui étudie les sociétés du Néolithique ancien (-7 000 ans) au travers de l‘organisation sociale et matérielle. Le travail du GEGENAA consistera à faire le lien entre le paysage et les matériaux employés par ces premiers sédentaires (calcaires, grès, parures en fossiles, argiles, etc.).
Nous prenons également part à plusieurs manifestations scientifiques sur la thématique du patrimoine culturel. À titre d’exemples :
- le Grand Reims, l’INRAP et l’URCA organisent le congrès annuel de la société française d’Étude de la céramique antique en Gaule du 10 au 13 mai 2018.
- le Colloque IMPACT 14-18 (GEGENAA) – impacts environnementaux et approches spatiales de la Grande Guerre, qui aura lieu le 20-21 septembre 2018 (en lien avec un projet financé par la Région Grand Est 01/09/2014 – 31/12/2018).
Enfin, d’un point de vue Enseignement, nous portons un nouveau master « Archéologie des Géomatériaux, Patrimoine » qui devrait débuter à la rentrée prochaine. Nous intervenons également sur la thématique des géomatériaux en Master « Géosciences et Risques » dans la mention de master 3G du département des Sciences de la Terre.