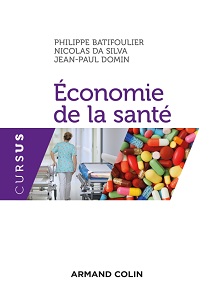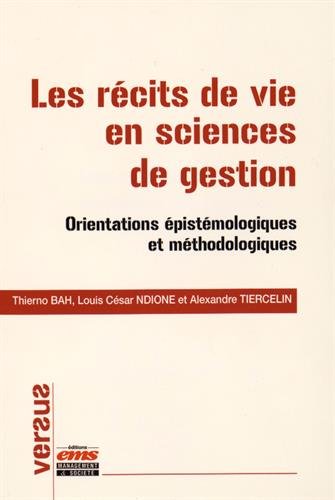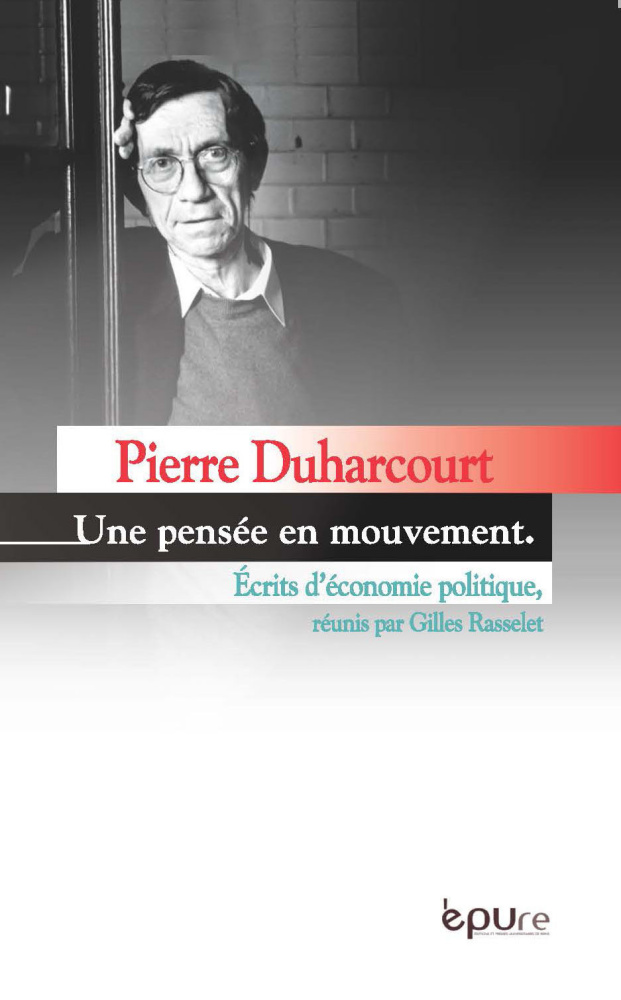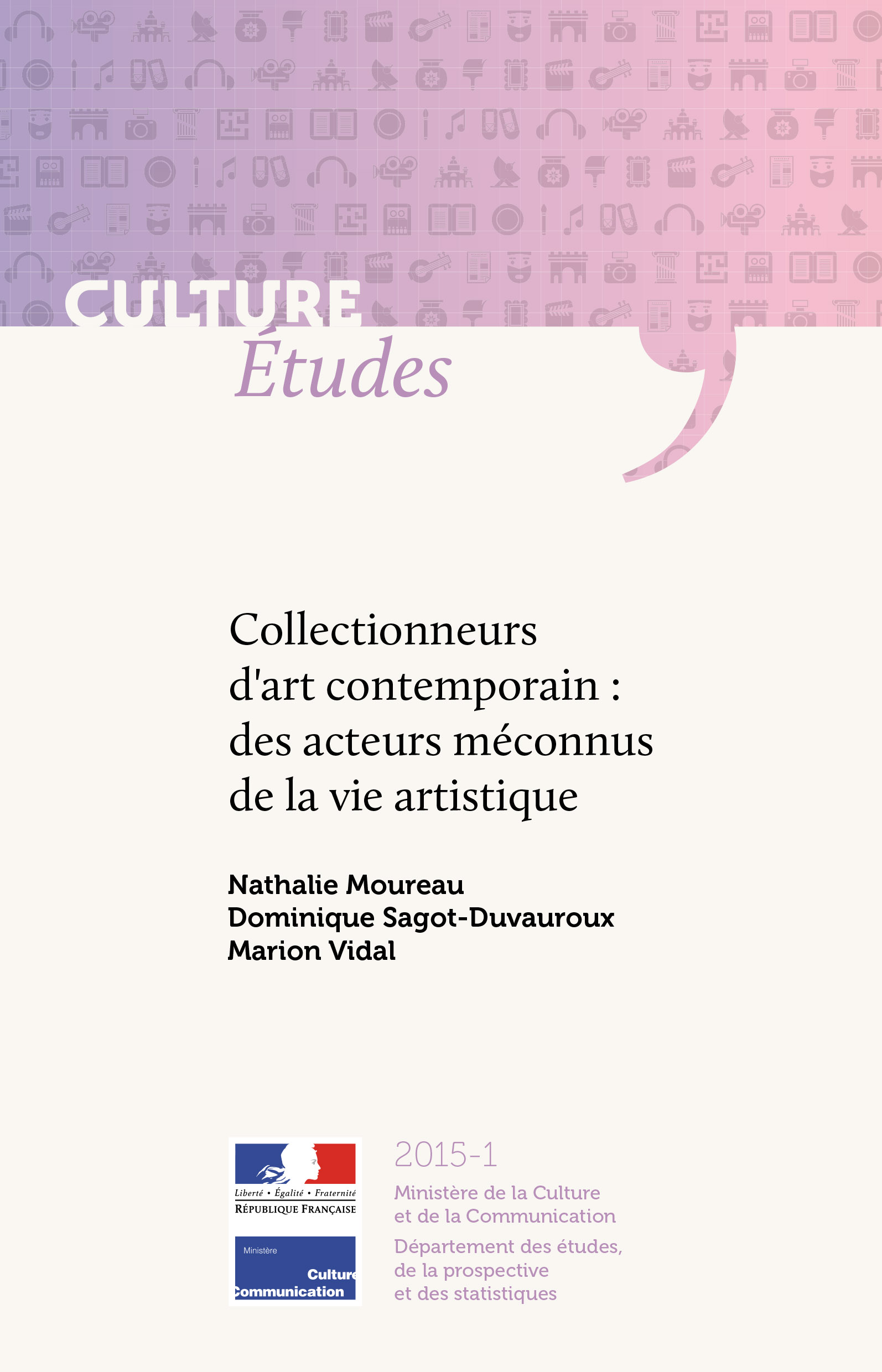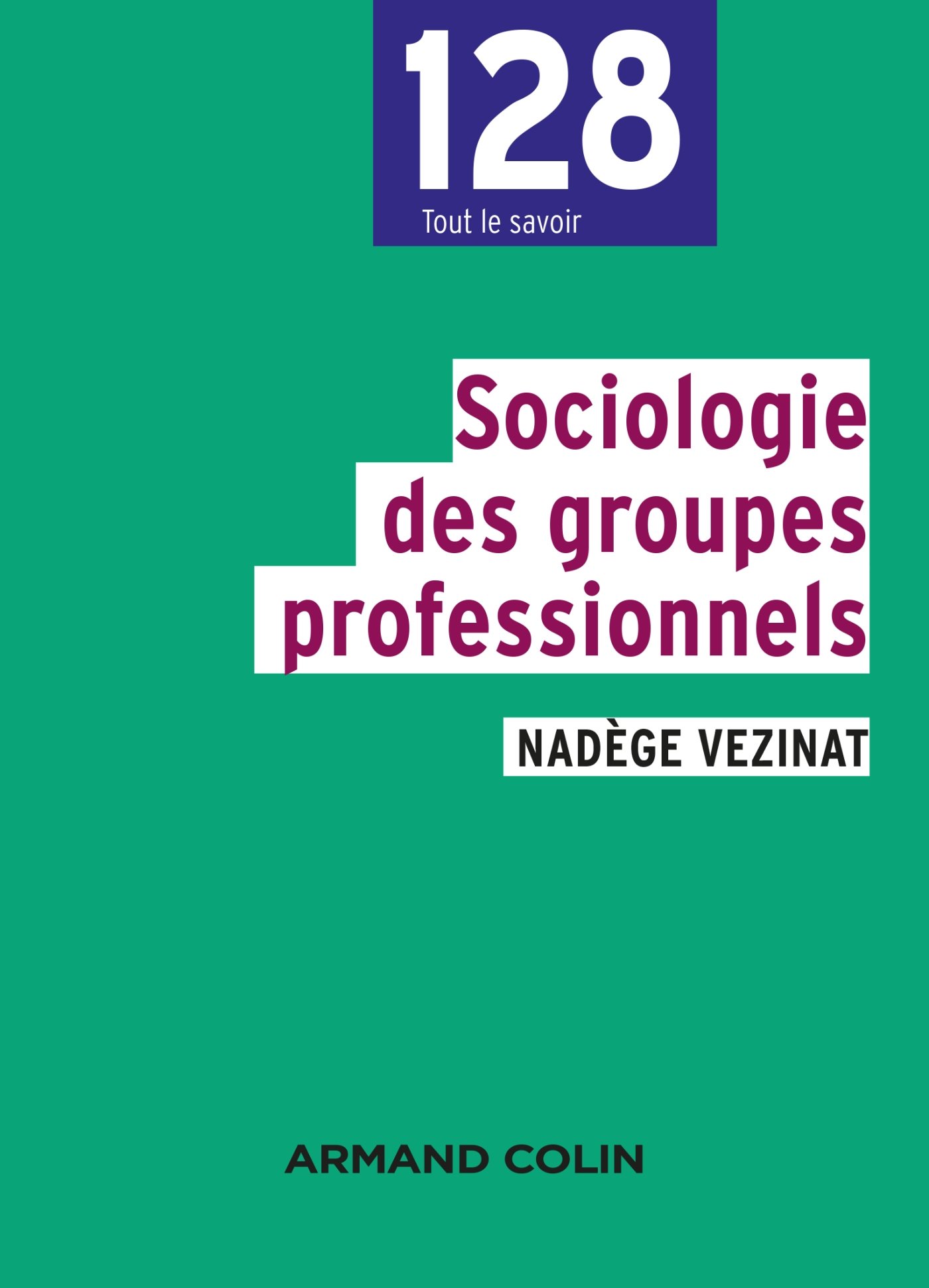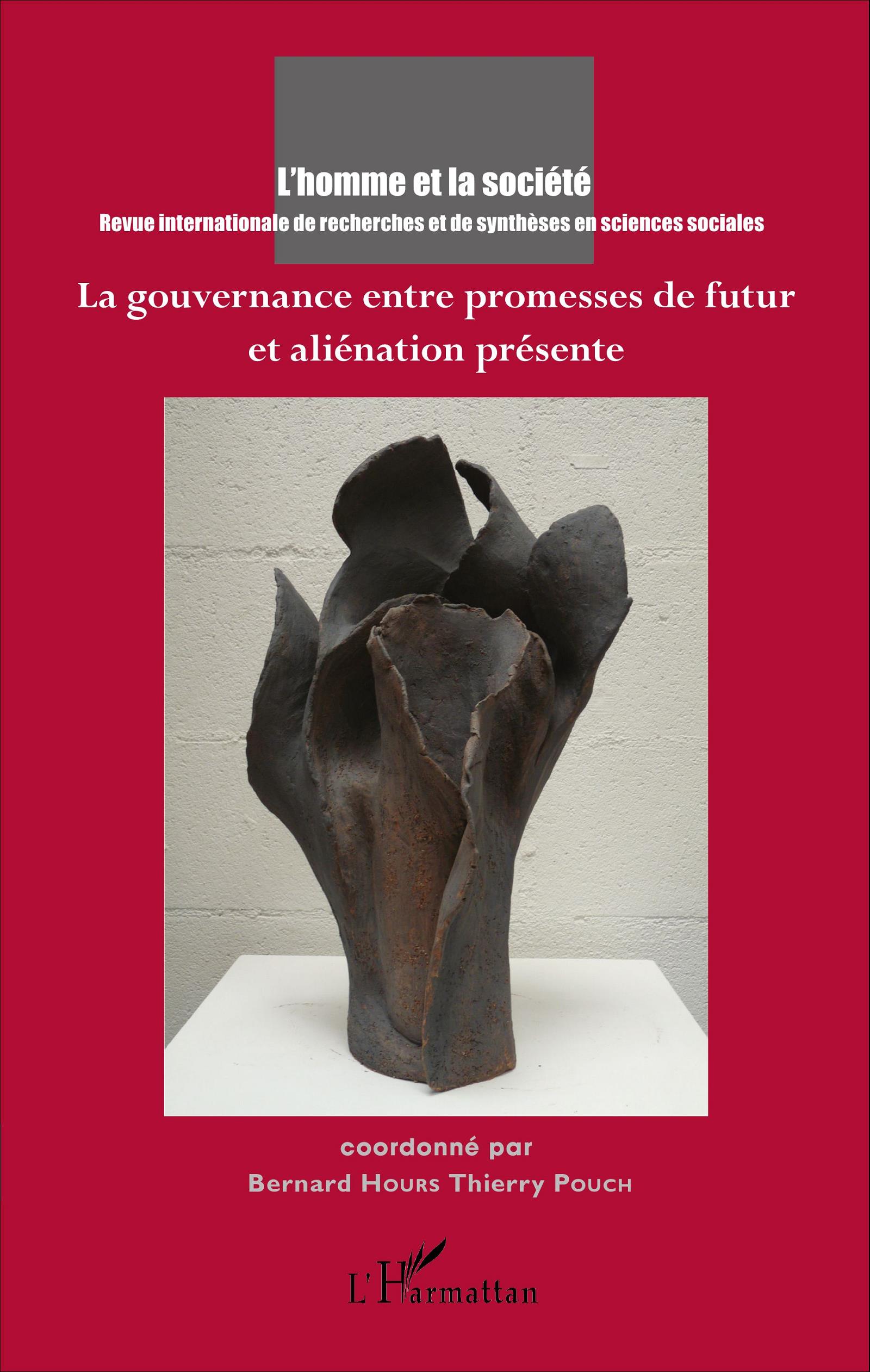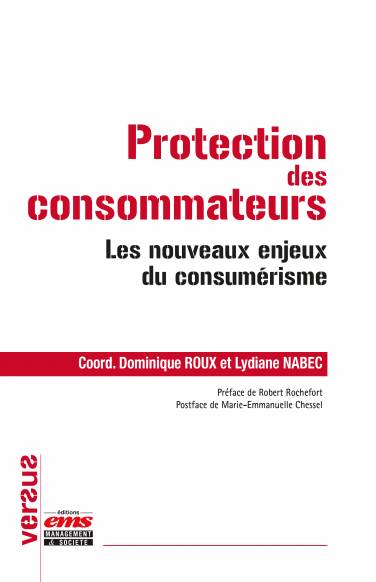Une économie écologique est-elle possible ?Olivier Petit, Iratxe Calvo-Mendieta, Géraldine Froger, Franck-Dominique Vivien...
Publication aux éditions L'économie politique n°69, Economie et écologie, Trimestriel, Janvier 2016, ISBN
Sommaire :
Qu'est-ce que l'économie écologique ?
Géraldine Froger, Iratxe Calvo-Mendieta, Olivier Petit, Franck-Dominique Vivien
Face à l'économie de l'environnement, l'économie écologique affirme que la nature n'est pas soluble dans le marché. Au contraire, la sphère écologique est intégrée dans un système plus grand, la biosphère, dont elle dépend. C'est sur ce socle commun que s'est construit un champ de recherche fécond au croisement des sciences de la vie et des sciences sociales.(€)
Flux de matières et d'énergie : produire dans les limites de la biosphère
Romain Debref, Martino Nieddu, et Franck-Dominique Vivien
L'analyse du cycle de vie des produits et l'écologie industrielle appréhendent la dimension biophysique des activités productives. Mais l'idéal d'une économie circulaire peut aussi se traduire par une pression accrue sur les ressources naturelles.
Controverses autour des services écosystémiques
Géraldine Froger, Philippe Méral, Roldan Muradian
Les écosystèmes naturels fournissent des services de toute sorte aux sociétés humaines. Cette reconnaissance a été portée par des économistes écologiques. Mais ceux-ci se divisent sur le risque d'une marchandisation de la nature.
Comment mesurer la soutenabilité ?
Philippe Roman, Géraldine Thiry, Tom Bauler
La nécessité d'indicateurs allant "au-delà du PIB" pour guider nos économies vers une trajectoire soutenable est désormais reconnue. Mais, selon les principes qui les inspirent, tous n'envoient pas les mêmes messages...
Maintenir le carbone en terre : l'initiative Yasuní-ITT
Franck-Dominique Vivien
Renoncer à exploiter certaines réserves pétrolières en échange d'une compensation financière de la communauté internationale : c'est la proposition qu'avait faite l'Equateur, mais qui n'a pu aboutir faute de financements suffisants.
Comprendre les conflits environnementaux : le cas de l'eau en Espagne
Olivier Petit
La nature est l'objet d'affrontements entre des groupes sociaux. La planification hydrologique en Espagne et sa contestation illustrent l'antagonisme des valeurs mises en jeu et les rapports de pouvoir qui s'y jouent.
Que valent les méthodes d'évaluation monétaire de la nature ?
Jean Gadrey et Aurore Lalucq
Donner un prix à la nature peut permettre de la défendre, dans un monde où la monnaie est le langage dominant. Mais cela peut aussi être contreproductif, tant les méthodes d'évaluation économique sont incertaines.
Après l'accord de Paris, priorité à la justice climatique
Eloi Laurent
La lutte contre le changement climatique ne réussira que si elle est juste. Pour accorder les Etats, la répartition des efforts de limitation des émissions doit être équitable. Pour mettre les sociétés en mouvement, la transition écologique doit être synonyme de progrès social.(€)
Sommes-nous trop nombreux ?
Hugo Lassalle
Y a-t-il trop de monde au "banquet de la nature" ? La polémique entre Malthus et Marx a longtemps structuré les débats sur la population. Il est clair aujourd'hui que la stabilisation démographique passe par le développement humain
Site de l'éditeur